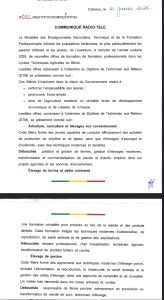EXPLOITATION SEXUELLE AU KENYA: Une enquête révèle le commerce du corps des enfants

EXPLOITATION SEXUELLE AU KENYA
Une enquête révèle le commerce du corps des enfants
Derrière l’effervescence des routes commerciales, la ville de Maai Mahiu, au Kenya, dissimule un trafic macabre : celui des enfants. Souvent orphelins ou issus de familles vulnérables, ils sont livrés à la prostitution sous l’emprise de femmes surnommées « madams ». Une enquête percutante de BBC Africa Eye publiée ce 4 août 2025, lève le voile sur un système organisé, banalisé et, surtout, largement ignoré par les autorités.
Une plaque tournante du commerce et du trafic
Située dans la vallée du Rift, Maai Mahiu est un carrefour stratégique pour le transit est-africain. Elle relie le Kenya à l’Ouganda, au Soudan du Sud et à la RDC. Chaque jour, des centaines de camions y circulent, alimentant une économie parallèle florissante de la prostitution.
L’enquête de la BBC a révélé une réalité bien plus sombre que le simple commerce du sexe. Dans l’ombre des projecteurs, ce sont des mineures, parfois âgées d’à peine 13 ans, qui sont offertes à des chauffeurs routiers en quête de « compagnie ». Ce système ne s’opère pas dans la clandestinité, mais au vu et au su de tous, y compris de la police locale.
Le rôle central des « madams »
Au cœur de ce réseau se trouvent les « madams », des femmes qui recrutent, forment et manipulent ces jeunes filles. Deux journalistes infiltrées, se faisant passer pour de futures proxénètes, ont mis en lumière leur rôle structurant dans le recrutement de mineures. L’une d’elles, Nyambura, a avoué face caméra, avec un cynisme glaçant : « Ce sont encore des enfants, donc faciles à manipuler avec des bonbons ».
Elle a même évoqué sans détour une enfant de 13 ans qu’elle « emploie » depuis six mois, tout en sachant que c’est illégal. Son discours expose une criminalité assumée, rationalisée et banalisée, où les enfants sont réduits à de simples marchandises.
L’inaction des institutions
Les preuves recueillies par les journalistes ont été remises à la police en mars, mais le résultat est révoltant : aucune arrestation, aucune poursuite, aucun suivi. La police invoque l’impossibilité de localiser les suspects et l’absence de plaintes des victimes. Un argument fragile quand on sait que le code pénal kényan prévoit des peines lourdes pour la traite et l’exploitation sexuelle des mineurs, même sans plainte formelle.
Cette inaction soulève une question essentielle : la protection des enfants dépend-elle de leur capacité à témoigner, même lorsqu’ils sont piégés par la peur et la manipulation ?
Une double peine pour les victimes
Les témoignages poignants de jeunes filles comme Lilian et Michelle révèlent un cycle de violence. Elles ont subi des abus sexuels et familiaux (oncles violeurs, mères absentes) avant d’être livrées à un nouveau cycle d’exploitation. Elles sont non seulement exploitées, mais aussi abandonnées par toutes les structures censées les protéger.
Un espoir fragile émerge avec Baby Girl, une travailleuse communautaire et ancienne victime. Elle héberge des filles, leur apprend des métiers et distribue des préservatifs. Cependant, ses ressources sont en train de s’épuiser suite à la décision de l’administration Trump de supprimer les financements à certains programmes de santé reproductive. « À partir de septembre, nous serons au chômage », a-t-elle déclaré, inquiète pour l’avenir des filles qui dépendent d’elle.
Une chaîne d’échecs systémiques
L’enquête de la BBC ne dénonce pas seulement un réseau de prostitution : elle met en lumière une chaîne d’échecs systémiques. Des enfants livrés à eux-mêmes, des femmes proxénètes qui agissent en toute impunité, une police passive, un État trop lent à agir et des financements internationaux qui s’effondrent.
À Maai Mahiu, les victimes ne sont pas invisibles, elles sont simplement ignorées. Tant que les institutions resteront silencieuses et que les responsables resteront impunis, ce commerce odieux continuera de prospérer.
Sous d’autres cieux, des enfants deviennent une proie facile. Triste!
Iréné N’KOUÉ (Stg)