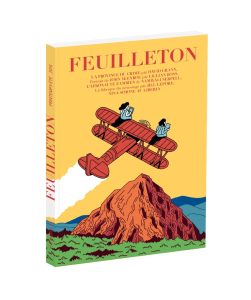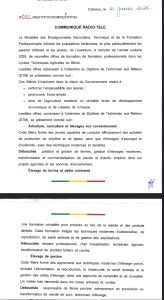LES COUPS D’ÉTAT RÉPÉTÉS EN AFRIQUE – SAUVEURS OU SYMPTÔMES D’UNE CRISE PROFONDE ?

Les récents coups d’État en Afrique, de la Guinée au Gabon, en passant par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, suscitent des interrogations sur la place des militaires dans la gouvernance des États. Les scènes de dirigeants civils déposés et remplacés par des hommes en uniforme sont devenues une triste réalité dans plusieurs pays du continent. Mais derrière ces actions spectaculaires, se cachent des causes complexes et variées, allant de la recherche de stabilité à l’insatisfaction populaire vis-à-vis de dirigeants au pouvoir depuis longtemps.
Certains considèrent les militaires comme des sauveurs, intervenant pour rétablir l’ordre et la sécurité dans des pays confrontés à des défis majeurs. En effet, l’incapacité des gouvernements civils à créer des conditions propices à la sécurité a ouvert la voie à des groupes extrémistes et à des conflits internes, plongeant ainsi certaines nations dans le chaos. Dans ces contextes, les militaires sont souvent perçus comme une force qui peut rétablir la stabilité et protéger la population des menaces internes et externes.
Cependant, il est essentiel de noter que les motivations derrière les coups d’État sont souvent plus complexes. La recherche de stabilité et de sécurité ne doit pas occulter les préoccupations démocratiques et les droits de l’homme. Dans certains cas, les militaires ont saisi l’occasion pour s’emparer du pouvoir et s’y maintenir, créant ainsi des régimes autoritaires sous couvert de sauvegarde nationale.
Les situations divergent d’un pays à l’autre. Depuis le 5 septembre 2021, la République de Guinée est dirigée par une junte militaire, avec à sa tête un ex-légionnaire de l’armée française, le colonel Mamadi Doumbouyah . Ce coup d’État militaire intervient au moment où le pays traversait de nombreuses crises, notamment économiques et politiques. La Guinée connait un lourd passé d’instabilité politique, comme la plupart des États africains, dû à la mauvaise gouvernance des élites. Le 30 septembre 2022, le Burkina Faso a subi son deuxième coup d’État de l’année, quand le capitaine Ibrahim Traoré, le chef de 34-ans d’une unité d’artillerie de l’armée du Burkina Faso, s’est autoproclamé chef de l’État. Après avoir renversé le chef de l’ancienne junte, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, Traoré a justifié sa prise de pouvoir en citant la détérioration de la sécurité au Burkina Faso., tandis qu’au Mali, le coup d’État de 2020 était en partie une réponse à la corruption et à l’instabilité politique. Au Gabon, les tensions entourant les élections présidentielles ont jeté une lumière crue sur le maintien au pouvoir d’Ali Bongo, provoquant ainsi une réaction des militaires.
Le cas du Gabon illustre particulièrement les dilemmes complexes liés aux coups d’État. La controverse entourant les élections et le maintien en place d’une dynastie politique ont alimenté le mécontentement de la population. Alors que les militaires prennent le contrôle, certains les considèrent comme des gardiens temporaires de l’ordre, tandis que d’autres craignent l’instauration d’un nouveau régime autoritaire.
L’idée que les militaires soient devenus les sauveurs des peuples est simpliste et doit être abordée avec prudence. Le rôle des forces armées dans la gouvernance devrait idéalement être temporaire, le temps de restaurer la stabilité, de mettre en place des réformes politiques et de permettre un retour rapide à un gouvernement civil démocratiquement élu.
L’envoi d’un message à l’ancienne puissance coloniale et à ses alliés occidentaux, ainsi que l’opposition aux gouvernements discrédités en place ont été les principaux facteurs à l’origine de ces coups d’État.
Au 30 août 2023, un total de six pays ont connu des coups d’État par des juntes militaires et un septième pourrait se dessiner le long des frontières du Gabon. Ces cinq pays sont le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, le Tchad, le Soudan et le Niger. Ces coups d’État s’inscrivent dans le contexte d’une lutte d’influence plus large entre l’Occident et la Russie en Afrique, où, selon les experts, la montée de la colère dans les anciennes colonies françaises a laissé la porte ouverte au Kremlin (gouvernement russe) pour en tirer parti.
L’Afrique doit s’efforcer de promouvoir des systèmes démocratiques solides, une bonne gouvernance et des mécanismes transparents pour éviter le cycle des coups d’État. Les militaires ne doivent pas être considérés comme la solution permanente à des problèmes profonds et systémiques. L’engagement en faveur du développement, de la démocratie et de la participation citoyenne reste essentiel pour l’avenir durable du continent.
Géraud Adoukonou